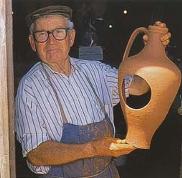Béja
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|
Cet article est une ébauche à compléter concernant une ville tunisienne, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
| Béja | |
|---|---|
 |
|
| Pays |
|
| Gouvernorat | Béja |
| Délégation(s) | Béja Nord Béja Sud |
| Gentilé | Béjaois |
| Maire | |
|
Latitude Longitude |
|
| Altitudes | moyenne : m minimale : m maximale : m |
| Superficie | ha = km² |
|
Population - Totale (année) - Densité |
56 677 hab. (2004[1]) hab/km² |
| Site Web | www.commune-beja.gov.tn |
Béja (باجة) est une ville du nord-ouest de la Tunisie située à 105 kilomètres de Tunis.
Chef-lieu du gouvernorat du même nom, elle constitue une municipalité de 56 677 habitants.
Au centre de l'une des régions les plus verdoyantes du pays, à la lisière des monts de Khroumirie et dans une trouée qui est une extension de la vallée de la Medjerda, la région de Béja présente des paysages variés : zones montagneuses densément recouvertes d'arbres, plaines agricoles et vallées fluviales.
Elle est le point de ralliement des agriculteurs de son arrière-pays qui y vendent les productions de leurs riches exploitations (vigne et céréales notamment) dans son important marché, fonction qu'elle occupe depuis l'époque romaine (son nom est alors Vaga). Elle dispose par ailleurs de la plus grande sucrerie du pays.
Parce que recélant en son sein de fortes potentialités (une grande partie de la population a moins de 25 ans), la région de Béja est l'objet de toutes les attentions gouvernementales : l'État y investit massivement dans le secteur agricole (irrigation), des infrastructures (extension du réseau de communication de téléphonie mobile) ou de l'enseignement (inauguration en 2002 du centre régional de l'Institut national de bureautique et de micro-informatique).
Enfin, non loin de Béja existent des vestiges archéologiques datant de l'antiquité dont ceux de Dougga qui est alors l'une des résidences des princes numides avant d'être un établissement prospère dans la province romaine d'Afrique. Il faut aussi mentionner la kasbah de Béja.
Les spécialités culinaires de la région sont la zlabiyya et les mekharek (pâtisseries).
Mahdia
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
| Mahdia | |
|---|---|
 |
|
| Pays |
|
| Gouvernorat | Mahdia |
| Délégation(s) | Mahdia |
| Gentilé | Mahdois |
| Maire | Mohamed Mehdi Sfar Gandoura |
|
Latitude Longitude |
|
| Altitudes | moyenne : m minimale : m maximale : m |
| Superficie | ha = km² |
|
Population - Totale (année) - Densité |
45 977 hab. (2004[1]) hab/km² |
| Site Web | www.commune-mahdia.gov.tn |
Mahdia (مهدية) est une ville côtière tunisienne située à 205 kilomètres au sud de Tunis. Chef-lieu du gouvernorat du même nom, elle constitue une municipalité de 45 977 habitants
Construite sur une presqu'île, elle abrite l'un des premiers ports de pêche du pays. De plus, l'activité touristique pèse de plus en plus dans l'économie locale. Enfin, c'est un centre tertaire dynamique qui a développé depuis quelques années un pôle d'enseignement supérieur (avec notamment l'établissement de l'Institut d'économie et de gestion ouvert en 1999).
Si le quartier historique de Mahdia se situe sur la presqu'île, la ville s'est étendue vers l'intérieur des terres (par les quartiers d'Hiboun et de Zouila notamment).
Sommaire[masquer] |
Histoire [modifier]
Ses noms historiques sont Jemma, Aphrodisium et Cap Africa.
Sa situation géographique stratégique et ses fortifications permettent à la ville de jouer un rôle de premier plan dans le bassin méditerranéen jusqu'au XVIe siècle. Mahdia est tout d'abord un comptoir phénicien puis romain sous le nom d'Aphrodisium[2] avant d'être officiellement fondée en 916 par le premier calife fatimide Ubayd Allah al-Mahdi[3] qui lui laisse son nom actuel. La ville devient ainsi la « capitale » des Fatimides en 921[3] et le reste jusqu'en 973, date à laquelle Le Caire devient capitale[4]. Assiégée durant 8 mois (944-945) par les kharidjites, la ville résiste victorieusement.
En 1057, les Zirides s'y réfugient face à la menace des Hilaliens. Roger II de Sicile (1er comte normand de Sicile) l'occupe en 1148 et maintient son assise sur la ville jusqu'à la chute de celle-ci, dans les premiers jours de 1160, aux mains des Almohades. La ville perd alors de son importance politique au profit de Tunis, mais n'en demeure pas moins un important port considérée comme la clef du pays.
La ville est la proie de plusieurs sièges. En 1390[5], devant la perte de ses positions commerciales en Tunisie en faveur de Venise, Gênes organise une expédition militaire voulant lui donner le caractère d'une nouvelle croisade au prétexte de venger la piraterie des barbaresques contre les chrétiens. Elle obtient l'assistance d'un corps de seigneurs franco-anglais, dont Louis II de Bourbon prend le commandement. La place, défendue par les Arabes de Bougie (Béjaïa), de Bône, de Constantine et des autres pays du Maghreb, venus au secours des Tunisiens, résiste à toutes les attaques, et les alliés, que les mésintelligences ne tardent pas à diviser, sont obligés de reprendre la mer après soixante et un jours de combats infructueux[6].
Mahdia est prise au XVIe siècle par le corsaire Dragut qui en fait son repère[7]. Charles Quint s'empare de la ville en 1550. Les Espagnols y restent jusqu'en 1554 et, en repartant, font sauter les remparts que les Ottomans ne reconstruiront que partiellement[8]. Depuis la ville a retrouvé son calme et est devenue l'un des plus grands ports de pêche de Tunisie.
La galère de Mahdia, remontant au Ier siècle av. J.-C. et chargée d'objets d'art athéniens est retrouvée à 6 kilomètres au large de Mahdia. Elle fait de la ville l'une des plus riches sites de l'archéologie sous-marine en Tunisie.
Ethnologie et histoire sociale [modifier]
Lors de l'évacuation de la ville, les armées espagnoles prennent soin d'expulser la quasi-majorité des populations autochtones[réf. nécessaire]. Paradoxalement, on sait peu de choses des Mahdois avant l'arrivée des Ottomans. Sont-ils chiites comme pourrait le supposer le passé fatimide de la ville ? Sont-ils en majorité « orientaux », à savoir apparentés aux Syro-Libanais ? Sont-ils tout simplement arabo-berbères comme leur environnement ethnique immédiat ? Il est difficile d'y répondre mais toujours est-il que, suite à la conquête ottomane, la ville est exangue. Toutefois, les nouveaux maîtres turcs comprennent facilement la haute valeur stratégique de Mahdia. Aussi s'empressent-ils de la repeupler. Beaucoup d'historiens tunisiens[réf. nécessaire] s'accordent à dire que la majorité des anciens habitants grossissent alors les rangs des villes de Monastir, Sousse ou Sfax tant l'avenir de Mahdia semble alors incertain.
La nouvelle occupation de la cité accouchera de l'un des renversements ethniques les plus radicaux et les plus singuliers de toute l'histoire tunisienne. Car, dans le cas de Mahdia, les impératifs militaires vont dicter aux Ottomans une voie différente par rapport aux autres agglomérations du pays : le délabrement économique et social est alors total et il est certain que la ville ne possède plus les structures administratives, culturelles et commerciales nécessaires à sa relance. Son élite est décimée ou dispersée et il est donc impératif de la remplacer. Fraîchement installés en Tunisie, les Ottomans se méfient par ailleurs fortement de cette élite urbaine arabophone, cultivée, sûre d'elle-même, frondeuse, influente et finalement très hostile. Poussés par la nécessité mais également le souci de maîtriser les côtes à moindre coût humain et militaire, les Ottomans repeuplent par conséquent la ville à coups de contingents entiers de mamelouks et de janissaires. Dès lors, quelle est l'origine ethnique des Mahdois actuels ? Il est diffcile de se prononcer de manière exacte. Pourtant, deux points paraissent incontestables :
- L'origine européenne ou caucasienne des Mahdois : À l'étude de la morphologie des familles traditionnelles de Mahdia, celle des Diar (terme arabe signifiant la « maison » au sens de la famille reconnue comme étant de souche), une impression se dégage : celle d'une population dont les traits physiques frappent par leur caractère européen : Les Mahdois sont généralement blancs de peau[réf. nécessaire]. Cette blancheur reste, dans la culture traditionnelle des classes moyenne et bourgeoise un référent fondamental de différenciation sociale. Si la distinction entre blancs et non blancs tend à s'estomper de manière publique, elle reste prégnante dans le cadre privé des relations interpersonnelles[réf. nécessaire]. Elle reste avec la langue, le critère de sélection par excellence, différenciant le beldi — habitant le bled, c'est-à-dire le noyau d'origine de l'agglomération urbaine —, le hadhri — mot provenant de hadhara (civilisation) — et le asli (habitant de souche) mais aussi l'individu urbain, de bonne famille et doté d'une bonne instruction et d'une bonne éducation, excerçant une activité libérale, commerciale ou intellectuelle au contraire des paysans, des ouvriers, des aroubis — mot provenant de arbi (arabe) en comparaison négative avec le beldi qui est généralement de souche européenne, turque ou juive) et des bedouis (bédouins).
- La grande homogénéité du peuplement
Économie [modifier]
Dynastie Ziride [modifier]
- Ziri ibn Menad (935 à 973)
- Bologhine ibn Ziri (973-983) - construit la ville musulmane d'Alger
- al-Mansur ibn Bologhine (983-995)
- Badis ibn Mansur (995-1015)
- al-Muizz ibn Badis (1015-1062) - les Hilaliens, envoyés par les Fatimides, détruisent Kairouan, la capitale des Zirides est transféré à Mahdia
- Tamim ibn al-Muizz (1062-1108)
- Yahya ibn Tamim (1108-1131)
- Ali ibn Yahya (1115-1121)
- al-Hasan ibn Ali (1121-1148)
Personnalités [modifier]
- André Halimi, journaliste français